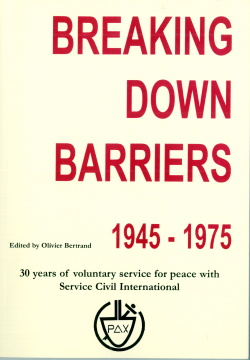Nicole Paraire
J’étais déjà engagée dans la vie professionnelle comme chercheur lorsque j’ai commencé à faire de l’alphabétisation. Quand j’ai commencé à travailler, je me suis dit qu’il fallait que j’aie d’autres activités. Il me semblait clair que les immigrés étaient opprimés et donc il était normal de leur donner un coup de main. J’avais commencé en 1970, à une époque où il arrivait beaucoup de monde, vivant dans des conditions épouvantables, notamment des Portugais fuyant la guerre en Angola. Et, faisant de l’alphabétisation, j’ai pensé qu’une bonne façon de mieux comprendre les gens avec qui je travaillais, c’était de les voir dans leur milieu d’origine. Quand une fille du groupe d’alphabétisation m’a dit qu’elle allait faire un chantier du SCI au Maghreb, ça m’a intéressé. Je n’ai pas choisi entre des associations de chantier, on m’a proposé celle-là. J’avais entendu parler du SCI une fois par une copine qui m’avait parlé de l’objection de conscience à une époque où, vraiment, ça m’avait fait tomber des nues – je n’y avais jamais pensé.
Nécessité d’une formation des volontaires
Théoriquement, il y avait (en 1973) beaucoup plus que maintenant, un cursus à suivre avant de partir en chantier dans le Tiers Monde, instauré par la Commission Afrique, Asie, Amérique latine (CAAAL) : une semaine de stage, plus un week-end de départ. A l’époque la formation des volontaires concernait la géographie, l’histoire, la sociologie et l’économie (relations économiques internationales). Cette formation me paraît capitale, même pour des chantiers de courte durée. Avec cette formation et avec les soirées, on remet les gens en question (qu’est-ce qu’un chantier, à quoi ça sert), on explique que l’essentiel n’est pas de creuser un puits et qu’ils ne feront pas toujours ce dont ils ont envie – trop de gens partent pour faire de l’humanitaire en pensant changer la face du monde en creusant un puits-. En une semaine, ils ont bien le temps de se reposer les questions, ou éventuellement de renoncer à partir et ça me semblait très important. Certains viennent suivre le stage sans vouloir nécessairement partir. On se rend aussi compte, en une semaine, si des gens auront des difficultés à participer à une vie collective. Et c’est vrai qu’elle est parfois difficile sur un chantier, dans un pays du Tiers monde. Il est arrivé qu’on dise à certains qu’ils vaudrait mieux qu’ils ne partent pas. D’autres se rendent compte que le pays dans lequel ils devaient aller n’était pas nécessairement le plus adapté.
Il s’agit de faire comprendre ce qu’est le développement, ce qu’est un pays du Tiers monde et de faire réfléchir aux raisons pour lesquelles certains pays sont développés et pas d’autres. Le SCI doit servir d’abord à la prise de conscience des volontaires eux-mêmes. On était très exigeants, avec une semaine de stage, un week-end de départ et un de retour ; donc ceux qui partaient étaient bien engagés.
Eventuellement après ils restaient au SCI. Maintenant, avec trois jours en tout, moins d’un volontaire sur deux vient au week-end d’évaluation et 1 ou 2% seulement restent au SCI. Cette diminution est intervenue depuis quelques années, en relation avec une compétition avec d’autres organismes beaucoup moins exigeants : en voyant que le nombre de participants aux stages SCI diminuait, la CAAAL (Commission mentionnée plus haut) a voulu faire quelque chose.J’ai rapidement fait partie du groupe des animateurs de la formation.
Ce qui m’a plu dans le SCI : c’était un endroit où on pouvait réfléchir. Ce n’était pas de l’activisme pour l’activisme. Et c’est sans doute pour ça que j’y suis restée. Ce n’est pas incompatible avec le travail manuel mais s’il n’y avait eu que le travail manuel, je ne serais pas restée. Ce n’est pas tellement le chantier qui m’a intéressée, mais c’est de réfléchir sur l’expérience qu’on y a connue. J’ai également fait partie d’un autre groupe de réflexion : le week-end de synthèse, que l’on organisait une fois par an sur un sujet donné, touchant au développement.
Un travail dur en Tunisie
Revenons à 1973 : ce chantier en Tunisie a été dur. Il m’a pris toutes mes vacances, soit trois semaines, alors que je travaillais. Il était situé dans un village. Il y avait au total une vingtaine de volontaires, toutes les filles étaient européennes, tous les garçons sauf un étaient Tunisiens. Il s’agissait de creuser des canalisations. Pourquoi et au bénéfice de qui ? Je n’en savais rien et à vrai dire cela m’était égal. Il était dur sur tous les plans, d’abord parce que l’interculturel est difficile, notamment dans un pays maghrébin, et il n’y avait pas de femmes maghrébines sur le chantier. Tout le monde ne venait pas du SCI.
C’était aussi dur physiquement. Je ne supporte pas la chaleur et elle était épouvantable dans le sud tunisien ; on nous vaccinait contre le choléra, car il y avait une épidémie. Donc on ne pouvait plus boire l’eau. On creusait en plein soleil des tranchées d’irrigation et nous les filles on creusait pendant que bon nombre de maghrébins se mettaient à l’ombre pour chanter de petites chansons. Par contre, ils étaient les premiers à la soupe ; d’ailleurs, je ne pouvais pas manger tellement c’était épicé. Dès qu’on parlait à un seul garçon, les autres étaient jaloux et faisaient une tête pas possible. La nuit, on avait droit aux transistors. Enfin, c’était très fatigant.
Le soir, il fallait faire son autocritique, parce que le chef de chantier était lui aussi mal à l’aise, parce qu’il n’avait sans doute pas l’habitude de gérer ce genre de groupe, il ne voulait pas qu’il y ait de problème. Si j’avais parlé à certains et pas aux autres, il fallait que je m’excuse, etc.. Je n’ai pas le souvenir de discussions organisées sur des thèmes particuliers. On avait déjà tellement de mal à faire face aux difficultés de la vie quotidienne. On était accueillis par une association maghrébine qui dépendait du Parti au pouvoir (le Destour), donc il valait mieux ne pas trop discuter. On avait surtout des échanges musicaux : il y avait danse obligatoire – danse tunisienne, naturellement - le soir.
Quand aux relations hommes/femmes, de toute manière au Maghreb elles sont quand même un peu hard. D’autant que ces jeunes n’avaient jamais été en contact avec des Européennes, ni même avec des femmes. Mais ce n’était pas aux femmes de préparer la nourriture. Il y avait un cuisinier, mais même les Tunisiens du nord ne pouvaient manger la nourriture tellement elle était épicée. Au total, j’ai eu beaucoup de mal.
Après le chantier, on a eu l’occasion, d’être accueillis par les familles des volontaires, ce qui nous a permis de découvrir un tout petit peu la vie là-bas. Quand je suis rentrée, je ne voyais pas de la même manière les gens avec qui j’avais affaire. Je pouvais parler de leurs coutumes, par exemple du mariage, on apprenait des petites choses, des blagues, des choses simples, on mettait les mêmes choses sous les mêmes mots. Avant, je ne savais pas.
L’intérêt d’un travail suivi avec le SCI
Le chantier a donc été très dur et pourtant je n’ai pas été découragée. Et ce qui était très bien au SCI, c’est qu’il y avait un week-end au retour, durant lequel on faisait une évaluation. On entendait les réactions des autres, on se disait : finalement c’était pas si mal. On valorisait ce qu’on avait fait. Et j’ai gardé jusqu’à maintenant une copine de l’époque. Parce que finalement, cette vie collective dans des conditions difficiles crée des relations indépendamment de tout, de la formation, de l’origine sociale.
On est obligé de faire face à quelque chose de tellement nouveau que cela crée vraiment des relations, sans en avoir discuté. Et c’est très bien. Et avec ce week-end de retour, on avait vraiment l’impression que le SCI, c’était une structure, qui ne faisait pas n’importe quoi, qui évaluait. Il y avait cet aspect de continuité qui m’a semblé très important.
A l’époque, le chantier était une porte d’entrée dans le mouvement. On nous proposait ensuite de faire des choses, dans le cadre de la Commission Asie, Afrique, Amérique latine du SCI, qui était très autonome (les animateurs étaient J.P. Petit et Gerson Konu). On nous proposait de choisir des thèmes de réflexion. C’était en 1973, date du premier choc pétrolier et j’ai eu la chance de pouvoir travailler sur un dossier concernant le pétrole ; c’est ainsi que j’ai appris comment le prix du pétrole était fixé, etc... C’est fondamental et c’est pour cela que je suis restée au SCI : on faisait travailler sa tête en même temps. Les années suivantes, j’ai continué à réfléchir sur d’autres dossiers: chacun travaillait dans son coin et nous nous rencontrions périodiquement.
Chantiers de courte durée en Inde et en Amérique latine
L’année suivante, en 1974, j’ai fait un chantier en Inde. C’était la première fois qu’il y avait un groupe constitué de volontaires à court terme qui allait en Inde . Le départ a été longuement préparé. Chacun devait se documenter. Il y a eu un chantier de week-end pour apprendre à se connaître. On devait rester en Inde un temps minimal, qui était très long : 7 semaines. Ayant une activité professionnelle, j’ai eu de la peine à trouver ce temps. Il y a eu une semaine d’orientation à Delhi, de longs exposés sur le SCI en Inde. Puis un chantier au sud de Madras, pour construire les fondations d’un dispensaire. Le chantier comportait des volontaires de courte durée français, encadrés par des volontaires à long terme indiens et occidentaux anglophones. Ensuite, on pouvait se déplacer un peu. Puis j’ai fait un séjour d’une quinzaine de jours dans un centre de santé d’un bidonville près de Delhi. On était présents, mais on ne travaillait pas vraiment, car on n’avait pas de compétence.
Aucun rapport avec le chantier de Tunisie. D’abord parce qu’on était invités par la branche indienne du SCI, à laquelle il semblait très important d’expliquer comment fonctionnait le SCI en Inde et aussi comment on vivait en Inde. Le SCI-India essaie de témoiogner, dans un pays où il y a tant de problèmes de caste, que des gens de différents pays peuvent travailler ensemble. Autre différence avec la Tunisie :sur le chantier femmes et hommes étaient en nombre à peu près égal. J’ai plus vu l’Inde que la Tunisie et j’ai été davantage frappée par la misère en Inde et par les beautés du pays qu’en Tunisie. Dans ma tête ce pays était magique, mais en fait il était très accessible. Mais voir ces situations de pauvreté était très dur. Par contre j’ai découvert la danse indienne qui est une merveille. Quant à la religion, on avait pu voir des cérémonies, mais, à première vue, elle bloquait beaucoup moins la vie quotidienne qu’au Maghreb. On nous a sûrement parlé de la non-violence au pays de Gandhi, mais je me souviens surtout d’une fin de match au cours de laquelle les gens se jetaient des pierres.
.J’ai aussi été, sous couvert du SCI., faire un chantier au Pérou à la fin des années 70 où il s’agissaitb d’apprendre à faire et à développer des photos à des animateurs par ailleurs très politisés.
Il y avait une responsable du SCI qui essayait d’avoir des relations suivies avec l’Amérique latine, mais c’était très difficile. Là-bas, on est gringo, si on n’est pas latino ou indio et on nous prenait pour des gringos. Une association comme le SCI aurait eu un vrai travail à faire, car en Amérique latine, tout est noir ou blanc. Il y est extrêmement difficile de dire ‘je suis non violent’, tout en étant de tel ou tel côté. Les latino-américains sont des théoriciens purs et durs.
A cette époque, il y avait des différences de sensibilité entre les branches dans leur approche de l’international et de ce qui était spécifique au SCI, question à laquelle étaient attachés les Français. Les Anglais étaient très pragmatiques, les Allemands avaient mauvaise conscience et voulaient donner de l’argent. Au contraire, nous pensions qu’il était impossible de faire du développement si on donnait de l’argent. Et ce n’est pas seulement à propos de l’Amérique latine. Je trouve que la collaboration entre les Européens est très difficile, parce que les orientations ne sont pas les mêmes.
De nouvelles formes d’échanges avec l’Afrique
Ensuite, j’ai fait partie de deux groupes : « Femmes et développement » et « Vendée ». Ce dernier s’appelle maintenant SCI Vendée/Afrique. Il était composé à l’origine d’agriculteurs et d’artisans qui voulaient aider le Tiers Monde et qui ne connaissaient pas le SCI. Gerson Konu, en tant que délégué international pour l’Afrique de l’Ouest du SCI leur a dit : « Si vous voulez aider le Tiers Monde, il faut d’abord apprendre à le connaître ». Il leur a proposé d’accueillir chez eux des gens du Tiers Monde. Il a fait très fort : il leur a fait accueillir pendant un an un Sénégalais, disons agriculteur, et un menuisier béninois . C’était difficile. C’était la Vendée profonde. On n’y avait jamais vu de noirs. Mais, comme pour mon premier chantier, ça n’a pas été un échec, ça dure encore et le groupe fonctionne toujours. Mais on a beaucoup évalué pour voir ce qui était positif ou non.
Ce n’est pas moi qui avait lancé ce projet. Avec du recul, je pense qu’un an, c’est beaucoup trop lourd pour ceux qui viennent, donc ils devenaient insupportables, ce qui est normal . Pour ceux qui recevaient, c’était moins difficile : le groupe étant assez nombreux, ses membres recevaient à tour de rôle dans leur famille (une quinzaine) les Africains. Il y a eu une suite. On a fait plusieurs évaluations. Il y a eu un autre accueil et puis on a dit aux Vendéens : « Pourquoi n’allez-vous pas en Afrique ? ». Donc maintenant, les Européens vont une année pour trois semaines en Afrique et les Africains viennent l’autre année en Europe.
C’est vraiment révolutionnaire. D’abord parce que les Européens ont compris le mode de vie des Africains. Ce n’est pas tellement que le projet ait été un moteur de développement. Au début, les Européens le croyaient ; ils ont pensé que le développement pourrait se faire comme ça. Ce qui est très intéressant, ce sont les échanges entre paysans : les partenaires se rendent mieux compte que chacun a un savoir, parce qu’ils ont le même métier. Ce n’est pas le SCI qui finance. On a organisé des opérations de financement suivant la méthode africaine : on a fait des champs collectifs, puis du ramassage de papier. Maintenant, on fait comme tout le monde pour gagner de l’argent, des repas payants.
Nous avons aussi organisé des soirées de formation et d’information.. On réfléchit sur les échanges « Europe-Tiers Monde ». La plupart des membres du groupe en remontreraient à beaucoup de ceux qui prennent des décisions sur les échanges avec le Tiers Monde. Quand on accueille (comme pour « Femmes et développement »), on emmène nos invités dans les écoles, où on donne beaucoup d’informations sur la vie en Afrique. Je vais toujours en Vendée, mais beaucoup moins. Les réunions ont lieu le soir. Ca s’est vraiment « vendéisé » ; ça prend racine, mais je ne suis pas sûre que ça dure longtemps. Il y avait des gens très divers et il faudrait qu’il y ait quelqu’un qui fasse le lien.
« Femmes et développement »
« Femmes et développement » est un projet lancé par le SCI au cours de l’Année internationale de la femme en 1975 (voir Dorothy). Deux Suissesses, anciennes volontaires à long terme, sont parties faire un voyage en Afrique de l’Ouest, ont rencontré des groupes de femmes et leur ont dit: « On n’a pas d’argent, mais qu’est-ce qu’on peut faire pour collaborer avec vous ». Et ça a été le point fort du groupe « Femmes et développement » : l’idée que d’abord, on n’a pas d’argent. Donc, on n’a jamais mis un sou dans les échanges et ça change tout. Les volontaires sont revenues en disant : « Les femmes disent, là-bas, qu’elles se découragent, parce qu’elles n’ont pas d’échanges entre elles ; le milieu n’est pas vraiment porteur ».
Nous nous sommes donc donné comme objectif d’essayer de faire le lien entre groupes de femmes làbas, pour essayer de les empêcher de se décourager. . Il n’y a rien d’extraordinaire à ce qu’un groupe en France fasse le lien entre groupes de femmes africaines, car, par exemple, les échanges postaux entre pays d’Afrique de l’Ouest passaient à l’époque par Paris. Dans notre cas, comme souvent, l’intérêt de l’élément extérieur, c’est qu’il pose des questions. Il fait réfléchir, donne du recul. C’est à cela qu’on sert, et à dire : « Vous faites ça comme ça ; à côté, ils font autrement… ».
En 1976, Gerson Konu a décidé d’organiser au Bénin une réunion internationale de groupes de femmes de l’Afrique de l’Ouest francophone. Or, c’est l’année précédente que le Dahomey était devenu Bénin et marxiste-léniniste. Nous nous sommes donc trouvés dans une situation extrêmement difficile, sur laquelle je pourrais écrire un roman. Les difficultés se sont posées sur tous les plans. . Il y avait une Suissesse, ma soeur, volontaire à long terme, Gerson et moi. Nous sommes arrivées, la Suissesse et moi pour préparer la réunion. Mais les choses ont été prises en mains par le Gouvernement qui a dit que c’était lui qui organisait et c’est lui qui a choisi les participants béninois. Comme c’était une réunion de discussion, il y avait toujours un commissaire politique qui assistait aux réunions et qui, à la fin de chaque réunion, une fois les internationaux sortis, remontait les bretelles à toutes celles qui avaient osé prendre la parole et émettre une opinion. C’était horrible, ça n’avait aucun sens. Il y avait des jours où on ne pouvait pas sortir. La cérémonie d’ouverture avait duré trois heures avec défilé militaire. Il fallait faire attention à ce qu’on disait. On ne savait pas ce qui nous attendait si on n’était pas dans la ligne, mais finalement on nous a laissés aller jusqu’au bout et repartir après la fin. On avait quand même créé des liens que l’on a pu maintenir, mais on n’avait pas pu discuter tranquillement.
A la CAAAL, on avait réfléchi à une charte qui définissait les principes des relations avec les partenaires du Sud, les conditions indispensables pour permettre les échanges. Et on disait que les échanges ne peuvent pas exister si d’un côté il y a celui qui a, de l’autre celui qui n’a pas, celui qui sait et celui qui ne sait pas, etc.. Si c’est ça, l’autre ne fait que dire merci et ce n’est plus un échange. Pour nous, c’est fondamental. « Femmes et développement » n’a pas d’argent, mais si un organisme quelconque ou une branche du SCI passait derrière nous, il en donnerait. Cela détruit une relation quand l’argent est en jeu. En moins de deux, on peut détruire une relation de travail. Bien sûr, le partenaire, entre celui qui donne de l’argent et l’autre qui dit ‘on va discuter’, il choisit celui qui donne de l’argent. Et avec l’UNESCO c’est pire. A l’une de nos réunions, des participantes nous ont demandé : ‘Et nos per diem ?’, alors qu’ elles étaient logées et nourries. Nous ne savions même pas ce que ça voulait dire. On s’est rendu compte que là où l’UNESCO était passée, nous ne pouvions plus passer.
A une autre réunion, au Burkina Faso, les représentantes de l’establishment monopolisaient la parole et prenaient toute la place. Nous avons compris qu’il fallait passer par les officiels, tenir les deux bouts de la chaîne : avoir l’assentiment des officiels et travailler avec la base ». Et depuis 30 ans, on a bien progressé dans le domaine des rencontres: on minimise les frais de déplacement, en faisant se rencontrer des femmes pas trop éloignées. Au début, les rencontres s’appelaient séminaires ; maintenant, ça s’appelle « chantiers-rencontres », donc on n’a pas le même public : on a un public qui sait qu’il devra travailler. Lors d’une rencontre, on réunit une vingtaine de participantes. Généralement, ce sont des déléguées d’associations locales que l’on a déjà rencontrées et qui sont d’accord pour participer à ce genre de rencontre, bien qu’elles sachent que ce sera dans des conditions modestes et que ça ne rapportera rien financièrement, ce qui est très à contre courant.
Généralement, le but de la rencontre, c’est l’échange sur leur fonctionnement en tant qu’association: comment faire pour l’améliorer. On échange aussi sur la condition des femmes et sur ce qu’on pourrait faire pour l’améliorer. On a aussi une activité manuelle organisée par le groupe d’accueil: souvent du reboisement. Une fois, on a demandé à chaque groupe de transmettre aux autres un savoir faire typique – et ça a très bien marché. Elles se sentaient responsables d’apprendre quelque chose aux autres. On ne fait pas mieux comme démarche de développement. Un groupe a appris aux autres comment faire des saynètes pour sensibiliser à l’alphabétisation (on en a fait dans le village). Certaines, qui ne le font pas d’habitude, ont pris la parole, y compris des femmes qui ne parlent pas français. Cela a permis à des gens de s’exprimer, de prendre une stature. Ensuite, chacun prend des résolutions pour améliorer son propre groupe et les Françaises vont sur place voir où ça en est. Le gros progrès récent, c’est qu’il y a eu des mini-rencontres sans participation SCI-Europe.
« Dans le groupe « Femmes et développement, l’objectif est de faire le lien entre les groupements de femmes. Nous avons différentes façons de faire : des rencontres, des visites, un journal, des accueils.
Concernant les visites, on va tous les ans voir ce qu’il se passe, car du côté africain on n’écrit pas beaucoup. L’autre action, c’est le bulletin de liaison, qui existe depuis la première rencontre. Nos partenaires nous écrivent ou on va les voir et on envoie les comptes rendus à tout le monde. Il y a eu une rubrique sur la pharmacopée, on a prévu une autre sur les droits de la femme et de l’enfant.
Et il y a une activité de financement : on fabrique du jus de pommes et on le vend, ce qui paie le journal. Les groupes en France prennent en charge l’accueil des Africaines qu’ils reçoivent et chacune de nous paie ses voyages de sa poche.
Nous organisons donc également des accueils de femmes, déléguées par leur association: on invite souvent deux représentantes par association. Du côté africain, on invite deux représentantes par association. Les Africaines viennent trois mois en France. Si on reste peu de temps, c’est du tourisme, on est émerveillé par ce qu’on voit et on conclut : « si on était blancs, on n’aurait pas de problème. Si on appuie sur le mur, il y a des billets qui sortent ». En restant trois mois, elles sont accueillies par des groupes, surtout à la campagne – ce qu’il y a de plus proche de leur mode de vie. Et à la fin c’est en région parisienne ; elles vont visiter les foyers de travailleurs immigrés, les femmes battues et on ne les prend pas en charge : elles doivent prendre les transports en commun. Elles trouvent ça insupportable. Par comparaison, la campagne paraît le luxe et on est bien entouré: à Paris on n’a pas le temps. Et, à la fin, elles sont tellement dégoûtées qu’elles ont envie de rentrer, ce qui est exactement notre but. Bilan : chacun doit porter sa charge ; nous aussi, on va courir – mais à notre rythme, disent-elles.
On a beaucoup réfléchi à l’accueil des Africaines. On a beau prendre des précautions, par exemple pour choisir celle qui vient, ce n’est pas nous qui choisissons. Mais il y a un tel mythe là-bas sur le fait de venir en France qu’il est important qu’il y ait quelqu’un pour préparer la personne qui vient et pour son retour. Parce qu’il n’est pas sûr qu’au retour elle soit bien accueillie. Ici, elle découvre tout de suite que ce n’était pas comme elle l’imaginait. Mais les gens qui l’attendent ! Et parfois, elle peut se faire exclure de son groupe. On a aussi beaucoup réfléchi à ce qu’on doit montrer et faire en France.
Au SCI, nous savons que la seule chose que nous faisons c’est de travailler dans le long terme, pour faire changer les mentalités, ici comme là-bas. Un chantier tout seul, pour moi ça n’a pas de sens, si ce n’est pas inclus dans une action plus durable. Puisque, de toute manière, ce n’est pas l’efficacité du travail concret effectué, c’est la relation établie, qui permet de réfléchir sur un mode de confiance. S’il est organisé par une association, il faut que ce soit un point fort, que ce soit dans sa logique. Si c’est juste pour accueillir des gens, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit inclus dans un long terme, ici comme là-bas. Quand on envoie des gens en chantier, on leur dit : ‘l’important, c’est d’y retourner et de retourner au même endroit’. Les gens qui vous revoient savent que vous n’êtes pas un touriste, que vous êtes venu comme ami. C’est important. Je ne passe pas mon temps à travailler gratuitement pour une agence de voyage. Si c’était le cas, je n’irais pas, même si on me dit que c’est une ouverture, qui fait évoluer. C’est vrai, les chantiers font évoluer, mais seulement s’ils sont préparés; sinon, il y en a qui reviennent racistes.»
Pour « Femmes et développement », on n’est pas suffisamment soutenues par le mouvement, alors que ses activités restent du SCI pur et dur. Pourtant, j’ai fait longtemps fait partie du Conseil d’administration de la Commission Afrique, Asie, Amérique latine. Et j’ai été quelque temps salariée à temps partiel du SCI pour l’Afrique de l’Ouest. Il y avait alors (et il y a toujours)un grand débat sur le rôle des permanents. Pour moi, dans un mouvement, les permanents assurent la permanence. Il y a des choses qui ne peuvent pas être faites par des gens qui ne sont pas permanents. Ca dépend de la taille de l’association et du type d’activité.
Un chantier récent en Algérie
En 2004, j’ai participé à un chantier en Algérie avec des membres d’une autre association dont je fais partie et qui reçoit beaucoup d’Algériens : ils voulaient savoir ce que c’était que l’Algérie. C’était très bien, car, dans le village où on était, ça faisait 42 ans qu’ils n’avaient pas vu un Français. Au bout de quatre jours, on nous a fait déménager. Paraît-il un ancien moudjahidine ne voulait pas voir un Français dans le village ; en fait il n’habitait pas là et les gens nous ont très bien reçu, comme toujours. Il n’y avait que notre groupe de volontaires des Ulis sur le chantier. L’association partenaire n’avait pas reçu un volontaire européen depuis 12 ans. Ils n’avaient que des Algériens, encore étaient-ils contents d’avoir des arabes dans des chantiers en Kabylie , ce qui n’est pas rien pour construire la paix. De toute manière, ça n’aurait pas été facile d’intégrer des jeunes dans un groupe de personnes de 12 à 67 ans. Mais à l’évaluation, on a dit qu’il était important que les Algériens voient des Français et que ceux-ci incitent à aller en Algérie.
A la question finale : c’est quoi le SCI ? je répondrais : C’est d’abord construire la paix, par des actions concrètes. Et longtemps, « on s’est battu avec les objecteurs de conscience » pour leur expliquer : « quand il y a des injustices dans le Monde, bien sûr que c’est ça la cause de la guerre ».