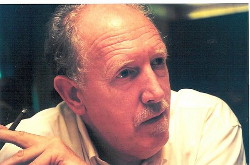David Palmer
Naissance d’une vocation
Lorsque j’ai eu onze ans, mon pêre, qui était contremaître dans une enterprise du batiment, s’est toutà-coup préoccupé de mon education. Il voulait que j’aille au lycée, qui me semblait reserve à des familles beaucoup plus bourgeoises que la nôtre. Lorsque j’ai quitté l’école à 15 ans, mon père m’a envoyé à la gare où il y avait un emploi de porteur. Grâce à la formation continue, je suis devenu employé. Mon travail me donnait quelque satisfaction et j’avais des possibilités d’obtenir une situation et une rémunération plus intéressantes en continuant à me former. Cependant, j’avais de plus en plus le sentiment que le fait de gagner simplement sa vie de cette manière ne valait pas la peine. A mes yeux, alors qu’il y avait tant d’injustice et de pauvreté dans le monde, la seule chose valable était de s’efforcer d’y remédier : tout le reste n’était que matérialisme égocentriste. De plus, je souhaitais très vivement voyager.
Un jour, l’un de mes collègues m’a montré un article de journal qui parlait des organisations de chantiers de travail volontaire. Une ou deux d’entre elles m’ont semblé n’être intéressées que par la recherche d’une main d’oeuvre bon marché et je les ai rejetées comme trop matérialistes. Je voulais faire quelque chose d’utile, aider les gens dans le besoin, sans esprit de retour. La seule organisation qui m’a paru moralement respectable était l’IVS, branche britannique du SCI. Après la description de l’organisation, l’article évoquait quelques uns des projets en cours. C’était la première fois que j’entendais parler des chantiers.
C’est ainsi qu’à l’âge de 17 ans, je suis devenu membre de l’IVS, auquel je faisais un don modeste. Il n’y avait pas de branche locale à proximité et mon seul contact était la lettre d’information. Durant l’été 1961, j’ai fait mon premier chantier. C’était – enfin ! – l’occasion de faire quelque chose d’utile, mais c’était aussi pour moi la première occasion de prendre mes vacances seul.
A cette époque, il était de règle que les volontaires commencent par faire un chantier dans leur propre pays avant d’aller sur des chantiers du SCI à l’étranger, mais je souhaitais aller dans d’autres pays et rencontrer d’autres gens. Par chance, l’IVS n’a pas appliqué la règle et m’a envoyé dans un pauvre village de Suisse (!). Pendant près d’un mois, j’ai aidé à construire une petite route rurale (voir Bhuppy au chapitre 3).
Un pauvre (?) village suisse
Il était alors de règle que les volontaires commencent par faire un chantier dans leur propre pays avant d’aller sur des chantiers du SCI à l’étranger, mais je souhaitais aller dans d’autres pays et rencontrer d’autres gens. Par chance, l’IVS n’a pas appliqué la règle et m’a envoyé dans un pauvre village de Suisse ( !). Pendant près d’un mois, j’ai aidé à construire une petite route rurale (voir Bhuppy au chapitre 3). A cette époque, Andiast était effectivement un pauvre village de montagne, où il n’existait qu’une seule voiture et très peu de machines agricoles modernes. On faisait les foins à la main et il n’y avait qu’une fontaine rudimentaire. Nous avons fait un travail manuel dur, en creusant une route dans les rochers.
Pour la première fois de ma vie, je me trouvais avec un groupe réellement international appartenant à une dizaine de nationalités. Le travail était dur, mais il me plaisait. L’objectif du chantier était simple et facile à comprendre, notre vie était bien organisée et la bonne entente régnait. La tâche de chacun, sur le chantier ou pour les corvées de ménage et de cuisine, était décidée en commun aux repas ou durant les réunions de chantier, un ou deux soirs par semaine. N’ayant pas eu l’occasion d’apprendre une langue étrangère à l’école, je n’avais que quelques notions d’allemand, et moins encore de français, mais j’aimais les contacts avec d’autres sans même connaître leur langue. J’appréciais les chansons, en particulier pendant les réunions d’adieu : après quelques mots du responsable, nous chantions « L’amitié », le chant du SCI et je trouvais ces moments émouvants. Le responsable avait beaucoup d’expérience. Il m’avait immédiatement impressionné par son calme et son charisme et par les récits qu’il faisait de l’Inde, où il avait été volontaire pendant une année. Cela faisait écho de manière étrange et contrastée aux années passées dans l’armée par mon père à la fin des années 30 et pendant la guerre. Avant même de quitter Andiast, j’avais pris ma décision : moi aussi je voulais être volontaire à long terme.
De retour à la maison, je n’ai pas cherché à cacher mon enthousiasme pour les chantiers de travail volontaire. J’avais participé à un travail utile répondant à mon idéal et j’ai commencé à préparer la prochaine étape. A cette époque déjà, les projets à long terme concernaient le développement et nécessitaient des volontaires ayant une qualification, ce qui n’était pas mon cas. Mais il y avait aussi des chantiers d’urgence et c’est là que j’avais mes chances, ayant déjà fait mes preuves avec le dur travail manuel effectué à Andiast. Mais je devais tenir compte du fait que je n’étais pas encore majeur et que mon père ne prévoyait pas pour moi un volontariat de longue durée. Avec notre niveau de vie modeste, je ne pouvais compter sur une aide financière de mes parents. J’ai donc pris un travail supplémentaire, trois ou quatre soirs par semaine, ce qui m’a permis d’économiser 50£. J’ai pu alors faire le grand saut.
Dans un hospice en Allemagne
J’avais déjà prévu de faire un chantier avec l’IVS pendant les vacances d’été. C’était juste avant mon vingtième anniversaire : j’ai dit à mes parents que je démissionnais de mon emploi pour aller faire un chantier en Allemagne et que je passerais par le siège de l’IVS à Londres pour m’inscrire comme volontaire de longue durée. C’était bien entendu un moment très émouvant. Ma mère regrettait de me voir partir, mais me laissait libre. Mon père a assez mal pris la nouvelle et m’a prédit que je reviendrais bien vite, sans emploi et sans argent. Je lui ai alors montré mes économies, ce qui l’a visiblement impressionné. Il est alors devenu plus conciliant et m’a dit que je serais toujours bienvenu.
Comme prévu, j’ai rendu visite au siège de l’IVS à Londres, pour confirmer ma demande de volontariat à long terme en Inde. On m’a répondu qu’à ce moment on ne pouvait me proposer que l’Algérie, pour reconstruire les maisons détruites pendant la guerre d’Indépendance qui venait de s’achever. On a insisté sur le fait qu’il faudrait faire un travail manuel pénible, dans des conditions de vie difficiles et que je devais prendre du temps pour réfléchir. J’étais très excité et j’ai répondu que j’étais prêt à partir immédiatement en me portant volontaire pour six mois. Mais la situation en Algérie à ce moment ne permettait pas d’envoyer davantage de volontaires.
Finalement, je suis parti pour plus de deux mois pour Neuenkirchen en Allemagne. C’était pour moi une surprise à plusieurs points de vue. Il s’agissait d’un camp de prisonniers – pas un camp de concentration, mais le même type de bâtiments. Nous étions dix ou douze volontaires, installés simplement mais confortablement dans ces bâtiments. Par rapport à Andiast, où les conditions de vie étaient assez primitives (nous couchions sur la paille et faisons nos ablutions à la fontaine), nous avions des lits et des douches chaudes et même un électrophone avec quelques disques classiques : un vrai luxe !
Par suite d’une pénurie aiguë de personnel dans un hôpital – en fait plutôt un hospice - nous devions aider aux travaux dans les salles de soin et parfois dans le champ de pommes de terre qui en dépendait. La plupart du temps, les volontaires travaillaient seuls pour aider la petite équipe d’infirmières. Je n’ai été qu’assez rarement et temporairement avec un autre volontaire. Notre travail était souvent sale et parfois dur pour les nerfs. Il n’y avait pas de service d’urgence, ni de bloc opératoire.
Apparemment, aucun médecin n’était attaché en permanence à l’hôpital. Pendant plusieurs semaines, j’ai surtout travaillé en gériatrie, avec des hommes : il fallait les faire manger, les laver et transporter leurs bassins. Chaque jour m’apportait son lot de chocs et ma quasi ignorance de la langue compliquait parfois les choses, aussi bien avec les patients qu’avec les infirmières.
Le responsable du chantier ne vivait pas et n’avait pas de relations avec nous, il ne participait pas au travail et était donc perçu comme quelqu’un de distant. Le 8 novembre 1962, dans son style formaliste habituel, il m’a informé que le Secrétariat international su SCI avait envoyé l’argent pour mon voyage à Tlemcen et que je devais partir le plus tôt possible.
Reconstruction à El Khemis (Tlemcen)

Mixing cement, El Khemis 1963
Le voyage en train de Brême à Rl Khemis prenait cinq jours. Le chantier était à environ 50 km de Tlemcen et à 20 km de la frontière marocaine, dans une région montagneuse à 1 000 mètres d’altitude. Les volontaires logeaient dans un fort abandonné par la Légion étrangère, sur un pic rocher dominant la vallée de l’Oued Khemis. Toute la région était sèche et rocailleuse, peuplée de redoutables cactus. Juste en face, de l’autre côté de la vallée, une chaîne de montagnes escarpées s’élevait jusqu’à 1 500 mètres. Le village d’El Khemis était en amont, à environ un kilomètre et demi. La verdure des oliveraies de la vallée et des coteaux contrastait fortement avec la terre brun-rouge des environs, avec sa végétation clairsemée.
Au Fort, les dortoirs, les anciens magasins et bunkers offraient un confort spartiate ; quelques uns seulement avaient un sol en dur, les autres étaient en terre battue. Quelques semaines avant l’arrivée des premiers volontaires – et en contradiction avec les ordres stricts du commandement militaire français de la région – les légionnaires avaient fait un travail minutieux de sabotage des installations (alimentation en eau et en électricité, égouts) et avaient tout saccagé. Les premiers volontaires du SCI avaient dû passer beaucoup de temps à rendre le Fort à peu près habitable.
Si, de manière générale, la population continuait à fêter l’Indépendance, la désorganisation était générale et il était très difficile de se procurer n’importe quels matériaux de construction – d’abord pour les réfugiés sans abri, en particulier dans cette région frontière. Dans le Fort, les portes brisées avaient été calfeutrées par quelques morceaux de bois récupérés et la plupart des fenêtres étaient remplacées par un assemblage de verre et de carton. La plupart d’entre nous couchaient sur le sol ; je m’étais débrouillé pour trouver un morceau de carton pour poser mon matelas.
A une centaine de mètres du Fort, on pouvait voir vingt ou trente assemblages de paille, de branchages, de morceaux de chiffons et de toile goudronnée, avec ça et là quelques tentes à demi effondrées. Autour de ce fouillis primitif, les restes d’une clôture en fil de fer barbelé. En regardant mieux, on s’apercevait qu’il y avait des gens qui vivaient là ! C’est ce qui restait d’un « camp de regroupement », dont les habitants n’avaient nulle part où aller.

Building Houses, El Khemis 1963
Ils vivaient dans une misère pitoyable, partageant leurs pauvres abris avec quelques poules. Leurs moutons, leurs chèvres et parfois un âne se blottissaient la nuit pour se protéger des chacals. Malgré leur extrême pauvreté, les maladies et la malnutrition, les habitants étaient toujours hospitaliers, toujours prêts à vous accueillir avec un thé à la menthe. Ils devaient être les principaux bénéficiaires du projet de reconstruction de Tlemcen. D’une façon quelque peu confuse, ils utilisaient différents termes pour parler du camp de regroupement, du fait de ses différentes localisations, avant et après l’indépendance. D’autant plus que l’identité tribale était également prise en compte. Pour le SCI, on parlait de Dar Mansourah et le village d’origine de la plupart des habitants s’appelait Beni Hamou.
Comme beaucoup de hameaux et de villages de cette region frontière, il avait été détruit par l’Armée française et ses habitants avaient été regroupés dans un espace clos par des barbelés. On ne voyait plus aucune trace d’habitation et l’ampleur des destructions était telle (on estimait que 90% des villages avaient été détruits), les ruines si nombreuses que je n’ai jamais su où était le site original de Ben Hamou. C’était de toute manière une partie du district administratif d’El Khemis. On prévoyait de construire à proximité 37 maisons, une école et une mosquée et d’autres aménagements étaient envisagés. A mon arrivée, il y avait une quarantaine de volontaires étrangers au Fort – ce qui faisait beaucoup de monde – et ce chiffre est monté à une cinquantaine au début 1963. Les Autorités algériennes avaient confié la coordination de l’ensemble des travaux au SCI pour l’ensemble de la Wilaya (le département), qui comptait 60 à 80 000 personnes.
En plus du chantier de reconstruction, il y avait plusieurs petites équipes de volontaires qui faisaient dans quelques villages du travail médical et éducatif, de la distribution de lait et parfois un peu de formation professionnelle. Ils étaient bien accueillis dans les villages. Quelques volontaires travaillaient aussi dans certaines villes de la région (Tlemcen, Marnia, Oran) comme infirmières ou enseignants. Au début de l’année 1963, une équipe mobile de réparation a contribué à la remise en état des installations sabotées : adduction d’eau et générateurs électriques. Avec cette dispersion des équipes dans différents projets, seulement un tiers ou un quart des volontaires travaillaient à la construction du village. Certains d’entre eux seulement – Algériens ou étrangers – avaient une formation aux métiers du bâtiment, ce qui ralentissait les travaux.
La plupart du temps, pas plus de 8 à 10 volontaires, quelquefois moins, étaient sur le chantier de construction, avec un nombre variable d’habitants de Dar Mansourah. Après six années de guerre, le nombre d’hommes dans la population avait beaucoup diminué. Bon nombre de survivants avaient passé plusieurs années dans le maquis pour combattre les Français. Il leur fallait maintenant reprendre les cultures, abandonnées depuis des années. La plupart des gens n’avaient pas grand chose à manger.
Les enfants de Dar Mansourah faisaient la queue chaque jour dans la cour du Fort pour la distribution de pain, de lait et de vitamines. Ceux de leurs pères qui travaillaient avec nous partageaient avec eux le pain et le café qu’on nous amenait en milieu de matinée et ils déjeunaient habituellement avec nous (sauf naturellement en période de Ramadan). Il fallait que ceux qui travaillaient dur soient bien nourris.
Le travail de construction progressait très lentement, d’une façon parfois pénible, principalement par suite du manque de matériaux – surtout le ciment – et d’équipements modernes. La première bétonnière est arrivée plus de trois mois après l’achèvement des premières fondations. Le transport était un problème permanent, à tel point que le travail devait parfois s’arrêter, pour quelques heures ou pour un jour. Etant donné la multiplicité des besoins des différentes équipes, la demande de véhicules était telle que nous ne pouvions en avoir un pour nous. Un vieux Combi Volkswagen nous transportait.
Une fois par semaine, les Autorités algériennes nous prêtaient pour un jour une camionnette avec son chauffeur – ce qui était insuffisant. Il arrivait souvent avec un chargement très attendu de ciment, denrée rare avec les besoins de reconstruction et les retards étaient source de frustration. Il était presque impossible de trouver des parpaings et l’on utilisait des blocs de pierre que l’on trouvait près du village et qu’il fallait briser à coups de marteau. A quelques kilomètres du fort, on allait aussi récupérer des éléments de béton dans les forts abandonnés près de la frontière. Il m’est arrivé de faire cinq ou six kilomètres avec un âne pour chercher un sac de ciment. Et il fallait au moins une journée de route pour chercher des pièces détachées pour la Land-Rover.
Des conditions difficiles et dangereuses
Le long des avant-postes fortifies, il y avait de multiples champs de mines posés par l’armée française près de la frontière marocaine, pour empêcher les mouvements de l’armée de libération algérienne. Ce dispositif de plusieurs kilomètres de long (qui avait son équivalent à la frontière avec la Tunisie) représentait désormais un héritage très dangereux. Parmi les fréquents appels d’urgence qu’elles recevaient, les équipes médicales étaient souvent sollicitées pour faire face aux conséquences de cette barbarie aveugle. Il était souvent difficile de trouver les victimes dans ces endroits dangereux. Il fallait souvent administrer de la morphine, puis nécessairement évacuer vers l’hôpital de Tlemcen les victimes, qu’il fallait souvent amputer et qui mouraient parfois.
A cette altitude, sur des terrains pierreux semi désertiques proches du Sahara, le climat est extrême et très dur : soleil brûlant, vent aigre, parfois chargé d’un sable qui aveugle bêtes et gens, ou de pluie glacée. De décembre à mars, nous passions parfois brutalement de l’un à l’autre. Bien souvent sur le chantier, sous les rafales de pluie, il nous arrivait de nous entasser comme un misérable bétail pour tenter de nous abriter sous des murs à demi finis, en attendant que le temps se calme en utilisant les sacs de ciment comme parapluies ou imperméables. De temps à autre, la température descendait à moins dix degrés et nous avions de fortes chutes de neige entre décembre et mars. Juste avant Noël, il devint impossible de travailler pendant plusieurs jours du fait de la neige. Quelques jours avant, nous avions pu avoir une plaisante baignade dans la rivière où nous allions chercher du sable.
Quand je suis arrivé au chantier, l’atmosphère paraissait détendue et conviviale. Au moins une douzaine de nationalités étaient représentées, surtout d’Europe de l’ouest et du nord, d’Amérique du Nord et d’Australie. Les responsables du projet et du chantier étaient tous deux britanniques. La langue française ne venait qu’au second rang entre nous, mais bien entendu, c’était la langue de communication avec les Algériens. A quelques exceptions près, les anglophones et les francophones ne pouvaient guère s’exprimer dans la langue de l’autre. Avec le temps, cette défaillance linguistique tendait à exacerber un malaise inexprimé mais palpable entre Français et Britanniques, qui avait naturellement de profondes racines culturelles et historiques.
J’avais été frappe dès le départ par le fait que certains volontaires ne prenaient pas la peine de venir aux réunions et j’ai bientôt constaté que la plupart des réunions tenues à El Khemis étaient l’occasion de récriminations et de l’expressions de diverses frustrations. J’ai rarement quitté ces réunions avec l’impression que ces réunions avaient permis de régler les problèmes et de repartir sur une base positive. Cela me semblait indiquer que l’organisation du chantier laissait à désirer.
Bon nombre de volontaires – moi-même compris – n’avaient guère de qualification particulière. Ceux qui avaient une compétence quelconque s’arrangeaient pour se trouver une fonction – une niche – particulière. Cela impliquait habituellement de se placer dans l’un des petits projets satellites – ou de s’en créer un et de s’absenter plus ou moins durablement du fort. L’impression d’un flux incessant de départs et d’arrivées s’en trouvait accentué. Nous manquions constamment de main d’oeuvre qualifiées pour le chantier, en dépit de demandes réitérées aux branches nationales par l’intermédiaire du Secrétariat international.
Comme si nous n’avions pas assez de problèmes, nous étions constamment à la merci de sérieux problèmes de santé, en particulier la jaunisse (aujourd’hui appelée hépatite), qui nous affectait beaucoup. A un moment donné, la majorité des infirmières et l’unique médecin étaient touchés. L’épidémie a contribué au mouvement des volontaires, un certain nombre d’entre eux ayant dû être renvoyés dans leur pays. Mais une forte proportion de volontaires n’étaient là que pour deux mois.
Il y avait de temps à autre une tendance, chez les volontaires à se regrouper en dehors du travail en groupes nationaux (ce qu’a déploré le Secrétariat international dans un rapport de janvier 1963). C’était particulièrement le cas pour les Suisses alémaniques et pour les Français, ainsi que pour le groupe britannique, ou plutôt anglophone. Les volontaires français, dont quelques objecteurs de conscience, étaient plus âgés et plus qualifiés que nous. Ils étaient généralement, ce qui n’est pas surprenant, beaucoup plus engagés dans ce travail que les autres volontaires. Il était clair qu’ils leur était parfois difficile de nous supporter, nous les jeunes, plus jeunes enclins à chercher du plaisir, de l’amusement et des aventures – et nous en trouvions.
Si les gens du pays étaient très pauvres, ils étaient aussi extrêmement hospitaliers et ils nous invitaient toujours chez eux. On nous recherchait particulièrement pour assister aux innombrables mariages qui ont eu lieu pendant ces quelques mois. Beaucoup de jeunes gens n’avaient pu se marier à l’âge habituel, parce qu’ils combattaient au maquis : il fallait se rattraper et il était d’usage d’inviter tout le monde aux cérémonies. Il y avait parfois deux ou trois mariages dans la semaine. Nous participions à de simples couscous, à des thés et, sous un ciel clair mais glacial, accompagnés par des musiciens itinérants, nous nous joignions à des danses échevelées autour d’un feu, jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Le travail sur le nouveau village avait commencé au début septembre 1962. A mon arrivée, trios ou quatre maisons étaient au moins partiellement construites. A mon départ, il y en avait une douzaine qui avaient une toiture. La construction du village d’El Fass s’est finalement terminée en octobre 1964, quand 37 familles ont pu s’y installer.
J’ai ainsi passé cinq mois excitants, mais difficiles, à El Khemis et je suis parti plutôt déçu de nos performances en matière de construction. J’avais des sentiments mêlés et je commençais à avoir des doutes au sujet des chantiers. Ma première critique concernant El Khemis concernait son caractère quelque peu amateur, les défaillances de l’organisation et de la gestion et le manque de direction (estce que nous ne nous étions pas dispersés entre trop d’activités ?). J’étais perplexe et il m’a fallu plus de quarante ans de réflexion, de discussions et de recherche pour arriver à une compréhension suffisante de cette expérience à la fois excitante et complexe
Iran: une autre organisation, un autre style
Photos
Dousadj 1963 (Iran)
6 images
In spring 1963, the SCI recruited David Palmer and other SCI volunteers to take part in the ‘Dousadj Project’- following an earthquake in Iran the previous year. The first international workcamp ever to take place in Iran, it was run by a new organization called the European Working Group (EWG), founded in June 1962 (it disbanded itself in 1969).
click on the photo
Avec quatre autres volontaires « expérimentés », nous avons été recrutés à partir d’El Khemis pour participer à un projet de reconstruction (le projet Dousadj) en Iran, à la suite d’un tremblement de terre survenu l’année précédente. C’était le premier chantier international organisé en Iran, par un nouvel organisme intitulé European Working Group, fondé en juin 1962[1]. Le SCI était l’une des associations qui contribuait au projet par l’envoi de volontaires. Il avait organisé un chantier de préparation des volontaires à Villepreux, près de Paris. Cette participation a contrasté à tel point avec celle du projet algérien que nous avons inévitablement fait des comparaisons entre les deux expériences.
Dousadj était l’un des 300 villages totalement ou partiellement détruits par le tremblement de terre survenu le 1er septembre 1962 dans la région de Kharagan, dans l’ouest de l’Iran. Trente volontaires (dont cinq femmes) avaient été recrutés pour un minimum de six mois, temps jugé nécessaire pour la reconstruction, qui devait être achevée avant l’hiver. Le voyage aller-retour des volontaires de Paris était pris en charge par l’aviation néerlandaise.
La main-d’oeuvre et les qualifications étaient abondantes. Chaque jour, une vingtaine ou une trentaine de villageois travaillaient avec nous, ainsi qu’un petit groupe de cinq à dix volontaires de l’Université et de l’Ecole polytechnique de Téhéran. Ils venaient pour des périodes de deux semaines,. Ils étaient en majorité opposés au Chah et étaient constamment sur leurs gardes de crainte d’être infiltrés par la SAVAK (la police secrète). Les plans pour la construction des maisons et du village étaient fondés sur une enquête préparée par l’Institut d’études sociales de Téhéran et les villageois avaient été consultés à chaque étape du projet. Il leur était demandé de travailler au chantier et ils recevaient une petite indemnité journalière pour qu’ils restent sur place en été plutôt que d’aller chercher un emploi saisonnier à Téhéran. Cela leur donnait le sentiment d’être propriétaires et de construire le village pour eux; ainsi, comme tous ceux qui participaient au projet, ils étaient soucieux de la qualité du travail. Une entreprise de construction apportait le personnel qualifié et un matériel adéquat (transport, centrale à béton). Nous avions même le luxe d’avoir un camion et un chauffeur fournis par le Croissant rouge pour nous amener au chantier à deux kilomètres de notre logement. Le financement ne semblait pas poser de problème. Et après avoir passé trois semaines à creuser des fondations, les volontaires ont eu la surprise de voir arriver une équipe de professionnels fournie par un sous-traitant pour les remplacer. Les volontaires ont alors été priés de trouver eux-mêmes un autre travail sur le chantier.
Bon nombre de volontaires venaient pour la première fois sur un chantier et certains n’avaient encore jamais travaillé. Durant la plus grande partie du chantier, je travaillais avec une équipe de six, dont Azziz, le forgeron du village, pour préparer les armatures métalliques servant aux fondations, aux murs et aux toits. A 2.300 mètres d’altitude, le climat était extrême et durant notre séjour la température est montée à plus de 40 degrés. De mini tornades et des tempêtes de sable étaient fréquentes. Le responsable du projet était un homme très capable, efficace et généralement respecté. Il avait été dans un kibboutz et avait étudié le développement communautaire dans des pays du Tiers Monde. Plutôt distant et quelque peu autoritaire, il faisait des efforts pour tenir les volontaires informés lors des réunions Mais il n’était que pendant le quart du temps sur le chantier et celui-ci devait s’organiser lui-même le plus souvent.. Le responsable du projet avait décidé qu’il n’y aurait pas de chef de chantier, mais seulement un coordonnateur pour assurer la liaison avec l’entreprise. Deux de ces chefs sont partis en raison de différends personnels avec le responsable. A plusieurs reprises, les volontaires se sont mis en grève et le fait de tirer au flanc était malheureusement assez fréquent, ce qui créait une mauvaise atmosphère sur le chantier.
Malgré tout, nous avons tenu les délais. Avec des techniques anti-sismiques, 116 maisons avec leurs dépendances, une école et un hammam ont été construits, avec une alimentation en eau. Le coût de la construction s’était élevé à 100.000£, dont 10 000 donnés par l’OXFAM. Peu après, en collaboration avec la FAO, l’EWG a mis en route un programme de développement agricole qui devait durer sept ou huit ans. Deux ou trois mois avant le recrutement de volontaires pour le chantier, elle avait organisé une campagne très médiatique aux Pays-Bas qui avait impliqué beaucoup de jeunes et eu beaucoup d’impact.
Bien entendu, une comparaison entre le SCI et l’EWG à partir de mon experience personnelle limitée serait injuste, bien que les deux projets de reconstruction aient eu beaucoup de traits communs. Mais le contexte n’était pas comparable. Les deux organismes étaient fondamentalement différents. Si le second avait des capacités de financement très supérieures, la principale différence concernait la manière dont le projet avait été préparé et organisé. .
L’apport de ces expériences
Après El Khemis et Dousadj, j’ai été responsable d’un chantier d’été de quatre mois de l’EWG en Norvège et j’ai participé à deux autres chantiers du SCI à la fin des années 60. Puis j’ai été totalement pris par mes responsabilités familiales et professionnelles.
Mes expériences avec le SCI et avec l’EWG ont eu une importance essentielle pour déterminer ce que je suis devenu aujourd’hui. Les idéaux du SCI : pacifisme, non-violence et droits de l’homme étaient dans l’esprit du temps au cours des années 60. J’ai apprécié le sentiment de me trouver en-dehors du système. La confrontation fréquente d’idées avec les volontaires m’a permis de me situer intellectuellement et a été très stimulante. Je me souviens par exemple d’une discussion très animée à El Khemis au sujet de la création du nouveau Peace Corps américain, que d’autres pays commençaient à copier. Pour la plupart, nous y étions fortement opposés, car à notre avis ce type d’organisation risquait de servir surtout les intérêts nationaux, voire impérialistes. Par la suite, malgré mon admiration pour le dynamisme et l’efficacité de l’EWG, je me suis senti mal à l’aise vis-à-vis du rôle prédominant des Hollandais et de l’establishment dans sa gestion. Pendant le chantier, certains d’entre nous ont pensé que le chantier servait d’abord les intérêts néerlandais et bien entendu la stratégie géopolitique de l’Occident. Cela m’a fait prendre conscience de l’intérêt d’une organisation internationale non-gouvernementale comme le SCI.
Les chantiers ont constitué une expérience unique dont j’ai beaucoup appris. Je pense notamment qu’en dehors de la beauté des paysages et la richesse des cultures, El Khemis étaient tous deux des pays où l’Islam joue un rôle très important. J’ai acquis ainsi une expérience de première main, grâce à mes contacts quotidiens sur le chantier et dans les villages. J’ai été frappé par l’hospitalité naturelle et la chaleur des relations, qui contrastent avec le style plus distant des relations et avec les valeurs plus individualistes des pays du Nord. C’est la base de mon intérêt continu pour la religion et la culture musulmanes en général, ainsi que de mon effort constant pour comprendre et pour voir avec plus d’objectivité les événements et les relations entre musulmans et non musulmans dans le monde.
Le travail sur les chantiers m’a aidé en quelques sorte à me trouver moi-même, à trouver ma voie en matière de carrière et d’une certaine manière, à mieux comprendre le monde. J’ai beaucoup appris sur la participation à un travail en équipe avec des objectifs communs, sur l’importance de la cohésion du groupe et sur l’organisation. Je pense aussi que c’est grâce à cette expérience que j’ai acquis une certaine conscience politique. Ce n’est pas par hasard qu’après les chantiers je me suis orienté vers des professions pour lesquelles un esprit d’équipe est essentiel : le travail social et l’enseignement.
[1] A la différence du SCI, l’EWG n’avait pas de membres volontaires, mais seulement un petit groupe de jeunes gens de différents pays d’Europe, qui souhaitaient créer une organisation européenne du travail volontaire, pour aider les pays en développement. Le siège était à Amsterdam et le Conseil d’administration, composé de personnalités, était présidé par une princesse de Hollande. Il n’y avait que quatre ou cinq salariés, dont l’un, Secrétaire international, était responsable du projet de Dousadj. Les volontaires ne relevaient de l’EWG que pour la durée du chantier. L’organisation avait pour objectifs : a) d’inciter les jeunes à prendre une part active aux problèmes majeurs du temps ; b) de leur donner l’occasion de partager la responsabilité d’une aide aux plus défavorisés. L’EWG se définissait comme non gouvernemental, indépendante des religions et a-politique. Son financement dépendait de dons venant de diverses organismes, etde fondations.