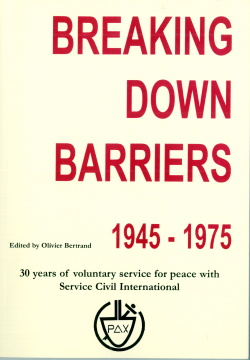Elisabeth Crook
Elizabeth « Didi » Crook, venue de Grande Bretagne, a fait son premier chantier en Autriche en 1961 avec l’Association pour les Nations Unies. Ayant une formation d’infirmière, elle a été recrutée par l’IVS, branche anglaise du SCI pour un service à long terme d’abord en Inde en 1962, puis au Japon.
Elle est rentrée en 1965 en Angleterre.
Premier contact avec les chantiers et le SCI A la fin des années 50 et au début des années 60, les réfugiés d’Europe centrale pouvaient se faire naturaliser dans différents pays. J’ai été en contact avec des réfugiés en Autriche qui avaient vécu parfois de puis 18 ans dans des baraques de réfugiés autour de Linz. On leur avait donné de la terre, mais il leur fallait construire leur propre maison. Cependant, même avec une assistance mutuelle, ils manquaient de main-d’oeuvre. L’Association pour les Nations Unies a donc organisé un chantier en invitant principalement des étudiants à travailler avec ces familles pour construire leur maison. Je n’étais pas étudiante, mais j’étais au courant comme membre du groupe des Nations Unies de l’université de Cambridge et j’ai passé mes vacances annuelles au chantier en 1961. J’ai appris ce que c’était d’être un compagnon bâtisseur.
Dans ce chantier, j’ai vu des affiches sur des infirmières des Nations Unies travaillant dans différentes parties du monde touchées par la pauvreté, le plus souvent à la suite de la guerre. Malgré ma formation de quatre ans en tant qu’infirmière, j’avais quitté cette profession et travaillait comme secrétaire à l’université de Cambridge. Je souhaitais avoir assez de confiance en moi et de compétence pour faire le même travail que les volontaires des Nations unies. Il m’a semblé que leur travail représentait aussi une contribution utile à la paix du monde et qu’il serait utile de mieux se connaître entre les différents pays. Mais je n’avais pas assez confiance en moi et en mes compétences.
J’ai pourtant continué à en parler et un jour, un étudiant m’a dit d’aller écouter une femme dont il avait entendu une conférence et qui avait fait un travail volontaire en Inde. Elle serait à Cambridge pour quelques jours. Je me suis crue obligée d’y aller, juste pour me prouver que je ne pourrais pas en faire autant. J’ai eu un entretien très intéressant avec elle (son nom était Cara Schofield) et j’ai appris qu’elle avait été volontaire au SCI. Je me suis alors décidée à aller au Secrétariat du SCI à Londres, puis j’ai eu un entretien et j’ai finalement été acceptée comme volontaire ! Je me suis alors rendu compte qu’il fallait passer à l’acte.
Avant de partir, comme je n’étais pas connue du SCI, on m’a dit de participer à un chantier de courte durée à Belfast, Irlande du Nord, pour un travail manuel consistant à créer un terrain de jeux pour un hôpital psychiatrique. C’est là que j’ai appris à me servir d’une pioche.
Faire quelque chose pour la paix du monde
J’ai rejoint le SCI à cause de ce besoin pressant que je ressentais de faire quelque chose pour la paix du monde. C’est peut-être parce que, comme enfant pendant la guerre, j’avais tellement entendu parler de ses horreurs et que j’avais vu des photos des camps d’extermination. C’est probablement la cause de ma dépression pendant mon adolescence, au moment de la guerre de Corée. J’ai toujours pensé que j’aurais pu naître n’importe où dans le monde et je me suis sentie privilégiée d’être en Angleterre, où nous avions supporté moins directement les atrocités de la guerre et la haine qui l’accompagne.
Comme enfant, j’avais aussi remarqué que l’« ennemi » que j’avais rencontré était en fait concrétisé par des prisonniers de guerre italiens, des gens charmants qui chantaient et aimaient les enfants. Dans mon esprit d’enfant, je me demandais donc ce qu’était réellement un ennemi.
J’attendais du SCI qu’un travail en commun avec des gens de nationalités différentes oeuvrant pour la paix puisse contribuer à celle-ci. Cela s’est produit à un moment où j’avais pour ami un réfugié hongrois et où j’appartenais au club d’outremer du groupe des Nations Unies de l’université de Cambridge et à une société bouddhiste, tous concernés par les mêmes thèmes. J’avais aussi travaillé pour le conseiller des étudiants d’outremer à Cambridge et participé à des rencontres avec des étudiants étrangers du British Council Avec les Tibétains à Dharamsala En dehors du chantier de deux semaines à Belfast avant mon départ, ma première expérience du SCI a commencé avec mon séjour en Inde comme volontaire à long terme pour plus de deux ans. Partie en 1962, je suis rentrée en 1965. J’ai d’abord travaillé avec des réfugiés tibétains à Dharamsala. Le Dalaï Lama était arrivé en Inde en 1959 et sa soeur aînée Madame Tsering Dolma était en train de créer une crèche pour les orphelins et pour les enfants de tibétains travaillant dans des conditions très dures en altitude sur les routes de l’Himalaya. Mon travail consistait à m’occuper aussi bien que possible de la santé des enfants et des adultes. Il y avait aussi une femme médecin de la Croix Rouge, mais elle était en bas de la montagne où vivaient les plus jeunes enfants. Les conditions de vie dans cet établissement étaient très rudimentaires : 200 garçons couchés dans une seule pièce, sept sur un même matelas sur des lits couchettes ou sur le sol. Malheur à celui qui tomberait de l’étage supérieur ! C’est un miracle que cela ne se soit jamais produit. Pour m’assurer que tous les enfants de cette pièce recevaient un vermifuge, je devais tous les traiter la même nuit car ils ne couchaient jamais au même endroit de sorte qu’il était difficile de savoir qui avait été traité la nuit d’avant. Il fallait vérifier la gale le jour du bain à l’unique robinet dehors dans la grande cour. On les changeait alors de vêtements de sorte que quand ils étaient nus pour le bain je pouvais les traiter. Il me fallait parfois demander la permission de vérifier l’état de leurs yeux et de leurs oreilles pendant les prières bouddhistes, le seul moment où j’étais sûre de voir tous les garçons et filles. Il y en avait en tout 250 à 300.
Il était impossible d’éviter la contagion dans des circonstances aussi extrêmes et les enfants mouraient parfois de la rougeole, maladie inconnue au Tibet. Ces enfants et adultes n’avaient guère d’immunité naturelle contre ces maladies, car l’altitude est si élevée au Tibet qu’il existe peu de maladies. Je travaillais avec le médecin herboriste tibétain ; nous discutions des cas et si nous étions en désaccord, nous pouvions en référer à Madame Tsering Dolma comme arbitre, mais nous étions en bonne relation. C’était essentiel car j’ai appris que par suite d’un incident avec la doctoresse de la Croix Rouge, qui n’avait pas autorisé les moines à pratiquer leurs rites pour les malades. Les Tibétains avaient commencé à cacher les enfants malades plutôt qu’à les amener chez le médecin. J’ai ainsi appris combien il était important de comprendre la signification des pratiques culturelles, de les respecter profondément et d’en discuter ouvertement. J’aurais tant d’autres histoires à raconter sur ce thème !
Par la suite, il est arrivé davantage d’aide à Dharamsala, principalement par le Save the Children Fund qui avait envoyé une infirmière rémunérée disposant de moyens financiers. Le SCI a donc considéré que je serais plus utile là où il n’y avait pas d’infirmière et m’a envoyée à la léproserie de Hatibari en Orissa. Il y avait eu une autre infirmière du SCI (Valérie Hagger) avant moi, mais elle était rentrée (elle m’avait aussi précédée avec les réfugiés tibétains à Kasauli). A Hatibari de nouveau, je n’avais ni argent, ni ressources, mais je recevais un peu d’argent de quelques généreux donataires d’Angleterre.
Chez les lépreux à Hatibari
Avant d’y aller, j’ai passé deux semaines dans un chantier de courte durée au village de Kalikapur, près de Calcutta : il s’agissait surtout d’un travail agricole avec des soirées consacrées à l’écoute de musique classique indienne ! C’était une merveilleuse expérience d’intégration !
Mon travail et ma vie à Hatibari représentaient à nouveau un changement culturel total. La plupart des lépreux (250) appartenaient à la tribu Adavasi qui vivaient normalement dans la brousse, mais il y avait aussi beaucoup d’Hindous y compris de la caste supérieure des Brahmanes.
Mon travail était le même : faire de mon mieux pour la santé des lépreux. Il y avait eu un grave problème de corruption par un médecin affecté à cet endroit, révélé par la branche indienne du SCI. Il était parti et n’avait pas encore été remplacé. Il y avait seulement deux bâtiments du genre étable et une grande pièce, en dehors des huttes de terre dispersées tout autour, occupées par un ou plusieurs lépreux et deux d’entre elles par notre petite équipe du SCI. Le responsable était un Indien de Calcutta (Maulik), il y avait un volontaire vétérinaire indien, un Français du nom de Félix ; un Canadien et une Finlandaise sont passés pendant mon séjour. Les autres travaillaient au développement de l’agriculture : du riz, des légumes et grâce à Oxfam un réservoir à poisson. La plupart des lépreux mendiaient avant leur arrivée, jusqu’à ce que le gouvernement de l’Etat d’Orissa et le SCI apportent la nourriture de base. Manger du riz et du dhal chaque jour est un peu monotone, d’où la tentative de diversifier les légumes.
Les bâtiments de genre étable comportaient des lits de corde qui sont devenus des salles communes d’hôpital pour hommes et femmes. La grande pièce était utilisée pour les traitements : administration des médicaments et traitement des ulcères. Il n’était pas possible de tester scientifiquement si les cas de lèpre étaient infectieux ou non, ce qui aurait été très nécessaire pour évaluer les doses correctes de médicament. Les effets de la lèpre pouvaient donc être limités mais il n’y avait pas de guérison comme c’est le cas aujourd’hui.
Je me suis peu à peu rendu compte que des gens venaient le soir, qui n’étaient pas vraiment malades ; ils souhaitaient seulement la compagnie. Avec quelque argent reçu d’Angleterre, nous avons alors acheté des jeux indiens et les avons installés dans la pièce, de sorte que cette grande pièce est devenue aussi un centre communautaire. Peu après, le brahmane a voulu discuter de la construction d’un petit temple qui s’est concrétisé et il a pu conduire les lépreux aux différentes cérémonies hindoues. Les gens sont peu à peu devenus un peu plus heureux, bien qu’ils aient été les plus pauvres que j’aie jamais rencontrés.
Je n’oublierai jamais le gourou nomade qui avait attrapé la lèpre et abouti dans notre communauté. Je l’ai mis à l’hôpital pour qu’il se repose et cesse de vagabonder ce qui aggraverait ses ulcères. Il faisait froid la nuit et quand il était là nous avons pu acheter des couvertures pour chaque lit. Lorsque j’ai fait ma « ronde de nuit » à l’« hôpital », tous les autres malades riaient et avaient leur couverture, sauf le gourou. L’un des lépreux, Nisakaru, s’était attribué le rôle d’interprète et lorsque je lui ai demandé pourquoi le gourou n’utilisait pas sa couverture, la réponse a été « C’est si extraordinaire de recevoir une couverture qu’avait de pouvoir l’utiliser je dois prier Dieu, mais je ne peux pas le faire avant le lever du soleil demain matin à l’heure des prières particulières. Je la prendrai avec moi pour dire merci et alors je pourrai l’utiliser ». Il l’a en effet utilisée la nuit suivante. Voilà un homme qui n’avait rien et qui attendait pour dire merci plutôt que d’attraper la couverture et d’avoir chaud . une expérience qui peut rendre modeste quelqu’un qui vient d’un mode occidental si matérialiste.
Un autre jour, un mendiant est arrivé pour être traité du pire ulcère que j’aie jamais vu (il ne lui restait que la moitié du pied). Je lui ai dit que je pouvais le traiter mais n’avais plus rien à lui donner à manger (nous étions au complet). Entendant cela, un homme dont la famille envoyait un peu d’argent s’est levé et m’a dit aussitôt : « Prenez-le je partagerai avec lui »). C’était très émouvant pour moi. Je suis heureuse de pouvoir dire que cet homme qui ressemblait à un squelette à son arrivée s’était bien étoffé trois mois plus tard et la plaie de son terrible pied était au moins guérie.
La rencontre avec les lépreux n’allait pas de soi : quand un nouveau arrivait à Hatibari, au lieu de la salutation indienne habituelle « Namasté » en joignant les paumes de la main, ils faisaient ce geste, mais prenaient les mains du visiteur dans les leurs et si le visiteur était réticent sachant qu’ils avaient la lèpre, ils le détestaient immédiatement. C’était peut être un peu méchant mais compréhensible. Ils mesuraient immédiatement l’authenticité de vos sentiments à leur égard.
Peu avant mon départ, un nouveau médecin a été nommé, mais il n’avait pas choisi ce poste, être affecté à une léproserie n’était pas utile à sa carrière. Il a été testé sur la salutation et il a échoué au test. Il s’est ostensiblement lavé les mains. Cette nuit-là, j’ai vu Nisakaru furieux allant et venant avec un bâton les yeux injectés de sang. Quand je lui ai demandé ce qui n’allait pas, il a exprimé sa fureur vis-à-vis du médecin, disant qu’à son prochain passage il renverserait sa voiture et y mettrait le feu. Il avait fumé de la marijuana plantée partout par les lépreux et j’ai eu de la peine à le calmer.
Nisakaru aimait rester avec moi dans la salle de soins. Il étendant ses longs bras sur la porte du placard et chantonnait doucement. A l’arrivée des patients, il traduisait : « Didi, cet homme a un défaut de la tête » (mal de tête) ou bien « cette femme a des défauts d’eau » (cystite). J’ai aimé la période passée à Hatibari, autant qu’à Dharamsala. Le pire moment a été celui où le nouveau médecin, lors d’une de ses visites, m’a appelée « Sale blanche » ! Le racisme à l’envers pour une fois !
Une clinique chrétienne au Japon
Le SCI voulait un volontaire anglais pour aller au Japon et comme j’étais déjà à mi-chemin, il a été décidé que j’irais. C’était beaucoup mieux organisé ! Je travaillais dans une clinique chrétienne d’un bidonville d’Osaka intitulé Kamagaseki. Cette fois, il y avait toujours un médecin présent, ainsi que deux infirmières. Je n’étais pas laissée à moi-même. La langue était un sérieux problème, mais les infirmières étaient bien disposées et parfois déconcertées, tandis que le médecin s’efforçait de communiquer en allemand ! Comme toutes les notices de médicament étaient en japonais, le médecin passait beaucoup de temps à les transcrire en caractères romains, en latin, de sorte que je puisse reconnaître les médicaments qu’il ordonnait. Il était merveilleux ; Les patients étaient soit des travailleurs coréens itinérants, soit des Japonais « burakus ». A cette époque, ceux-ci étaient traités comme une classe à part, comme les intouchables en Inde ; ils étaient très méprisés et leurs possibilités d’accès à un emploi étaient très limitées lorsque l’on connaissait leur origine. Une petite fille de sept ans qui rendait visite à la clinique, m’avait « enseigné » quelques rudiments de japonais et j’essayais de faire des phrases. J’ai décidé d’en faire usage lors d’une réception organisée par un professeur de l’école dentaire. Imaginez l’horreur de ses invités distingués lorsqu’ils ont entendu une femme étrangère leur parler avec la langue des « Burakus » ! Le professeur a reçu des plaintes ! Il a trouvé ça amusant, mais il a décidé que je devais apprendre un meilleur japonais, en échange de leçons d’anglais que je donnerais à ses étudiants.
Le Japon a représenté pour moi un choc culturel beaucoup plus difficile que celui que j’avais connu avec les Tibétains ou les Indiens. En partie parce que je m’attendais à ce que les Japonais soient plus proches des Anglais, puisqu’ils vivaient dans un cadre urbain moderne et portaient les mêmes vêtements. Mais mes rapports étaient dans l’ensemble facile avec les Tibétains et les Indiens, alors que je me suis toujours sentie un peu mal à l’aise avec les Japonais - en dépit du fait que lorsque j’étais làbas j’avais un merveilleux boy friend que j’aimais beaucoup. J’ai appris peu à peu que les Japonais avaient aussi des sentiments très forts, mais leur culture ne leur permet pas de le montrer.
Progressivement, j’ai acquis une sorte d’intuition des sentiments ressentis par les autres – et il me fallait savoir si et quand je devais montrer que je les avais compris. C’était un monde très contrôlé et difficile pour moi. J’ai participé à deux autres chantiers de plus courte durée : un chantier d’aide d’urgence suite à un tremblement de terre à Niigata (creuser des latrines et surveiller pendant la nuit une école, où étaient abritées les victimes pour éviter les pillages) et faire les foins à Hokkaïdo : un merveilleux souvenir !
Surmonter les différences, renoncer aux idées préconçues
Comme volontaire à long terme, mon travail a consisté essentiellement à avoir la responsabilité de la santé des personnes en faisant ce que je pouvais, habituellement sans médecin et avec peu de moyens, en dehors des connaissances acquises par ma formation et des manuels. Encre fallait-il sérieusement adapter ceux-ci à l’absence d’un bâtiment adéquat (sauf au Japon), de conditions stériles et d’un médecin. Les pansements, le coton et le reste étaient achetés avec l’argent envoyé par des Anglais désireux de nous aider. J’avais apporté mon propre matériel médical, stéthoscope et autres.
Mon séjour a répondu à mes attentes, car les relations avec les gens du SCI et avec ceux pour qui et avec qui je travaillais m’ont fait prendre conscience de ce que l’on pouvait faire pour la paix. C’était plus encore le cas quand la situation était la plus difficile : je devais alors être moi-même vigilante pour contrôler mes réactions si je voulais travailler pour la paix et surmonter les différences avec les autres. Il me fallait parfois renoncer à mes idées préconçues, comprendre le point de vue opposé et trouver un terrain d’entente pour continuer à travailler ensemble. Il faut que la volonté de s’entendre soit plus forte que le désir d’avoir raison.
Au cours des années 90, j’ai fait de la formation pour les volontaires partant pour l’étranger du Voluntary Service Overseas (V.S.O.). J’ai trouvé que ce dispositif présentait un inconvénient par rapport au SCI des années 80 : l’Angleterre (avec une aide gouvernementale) envoyait une « aide » aux pays, mais il n’y avait pas d’égalité permettant des échanges de volontaires, alors qu’au sein du SCI tous étaient membres d’une même organisation offrant une aide mutuelle. Il m’a semblé que beaucoup de volontaires du V.S.O. ne partaient pas avec un idéal, mais plutôt pour ajouter quelque chose à leur curriculum vitae ou par goût des voyages, ou encore faute de trouver un emploi. Cela dit, de nombreux volontaires du V.S.O. revenaient en étant marqués par leur expérience et continuaient à travailler dur pour contribuer à un monde moins inégal et plus ouvert. Un volontaire m’avait dit : « Pendant les années 60, vous étiez idéalistes, aujourd’hui (les années 90), nous sommes plus réalistes ». Est-ce vrai ? Il me semble que l’on peut être idéaliste et réaliste à la fois.
Retour sur le SCI
Je crois toujours profondément aux idéaux du SCI, que j’ai partagés toute ma vie et mon désir de paix et d’harmonie est toujours aussi fort. Si seulement les organisations d’aide partageaient les mêmes croyances et si davantage de gouvernements mettaient les mêmes valeurs au coeur de leurs idéaux et de leurs pratiques !
Le SCI était-il efficace ? Je crois qu’on aurait pu le critiquer pour ne pas l’avoir été autant qu’il aurait pu l’être. Il y avait une certaine tendance à faire confiance à la providence. A l’inverse, le V.S.O. peut être aujourd’hui considéré comme un organisme très efficace, mais avec des règles strictes, des entretiens et une formation préalable, un suivi constant des « volontaires » et de leurs conditions de vie. Au SCI, on nous laissait nous débrouiller et nous vivions exactement comme les gens avec lesquels nous travaillions. Bien sûr, l’organisation de V.S.O . est entièrement différente : elle est aidée par le gouvernement, et les « volontaires » reçoivent un salaire équivalent au salaire local. Au cours des années 50 et 60, les volontaires du SCI étaient vraiment jetés à l’eau avec peu de préparation, sans formation préalable au pays dans lequel ils se rendaient et souvent très loin du siège du SCI. Il n’y avait souvent aucun autre volontaire britannique dans le pays concerné et finalement aucun système de gestion.
L’impact du SCI est difficile à évaluer. En Inde, j’étais dans un milieu d’une pauvreté telle que l’on pouvait tout au plus maintenir les gens hors de l’eau. Mais certainement des enfants tibétains ont pu grandir de manière saine et connaître un certain bonheur, des mendiants lépreux ont pu vivre plutôt que mourir et appartenir à une communauté, avec un temple qu’ils avaient construit, en observant des rites religieux, ce qui leur donnait une autonomie et un cadre de vie. C’était bien préférable à la mendicité, à l’aggravation de leur maladie et à une mort solitaire.
Au Japon, un volontaire britannique travaillant dans les bidonvilles avait un grand impact sur la paix – à tel point que je suis passée à la télévision ! J’étais donc bien placée pour dire pourquoi je faisais ce travail. D’autant plus que j’étais avec des « Burakus », un groupe de Japonais qui a été de tous temps méprisé par ses compatriotes et avait difficilement accès à un emploi.
Pour moi-même les bénéfices de cette expérience ont été considérables. Elle m’a aidé à me considérer comme une personne plus authentique, car je savais que je vivais en conformité avec mes valeurs, alors qu’auparavant je ne savais comment y parvenir. J’ai eu l’impression d’avoir davantage de prise sur ma vie. J’ai appris que je n’avais pas besoin de faire mes preuves, pas même auprès de moi-même.
Je me suis jugée moi-même sans avoir besoin du jugement des autres et cela a été un élément essentiel de mon développement. Alors que j’étais très dépendante, je suis devenue une personne indépendante.
Cette expérience a entraîné une réorientation professionnelle complète, même si au début j’ai été totalement perdue. Après avoir bénéficié de services d’orientation professionnelle, il est devenu clair que j’étais beaucoup plus intéressée par le travail social que par la médecine et je me suis donc réorientée dans ce sens avec une formation complémentaire. A mon retour, j’avais pensé que je ne pourrais pas être efficace autrement qu’en retournant en Inde ou un pays semblable. Je pouvais maintenant comprendre que l ‘oppression et la pauvreté sont relatives en fonction de votre pays et j’ai pu travailler en Angleterre conformément à mes valeurs.
L’effet a-t-il été durable ? Outre ma réorientation professionnelle, cette expérience a déterminé mon attitude vis-à-vis de la politique alors que je n’étais nullement politisée. Désormais j’étudiais soigneusement les programmes des partis politiques .Je n’ai jamais adhéré à l’un d’entre eux, mais de plus en plus, surtout depuis que je suis retraitée je participe à des groupes de pression et contribue à des campagnes pour influer sur la politique et sur le public (les droits de l’homme, la lutte contre la torture, l’environnement, les réfugiés...). J’ai aussi fait de la formation contre le racisme. J’ai beaucoup voyagé car je suis curieuse de la manière dont vivent les autres peuples et de leur environnement. Je me rends compte de plus en plus que nous ne sommes qu’une petite partie d’un vaste monde. Je m’inquiète de voir les grandes multinationales influencer les gouvernements et de constater que l’avidité et la volonté de pouvoir sont aujourd’hui des forces dominantes, au lieu de viser un monde plus harmonieux et plus solidaire.
Je ne me suis pas beaucoup occupée du SCI en Angleterre ces dernières années. Il semble avoir réduit ses activités et n’avoir que peu de volontaires à long terme principalement en Afrique. Il semble y avoir beaucoup de chantiers de courte durée. Je ne sais si les jeunes qui y participent sont aussi soucieux de la paix que je l’étais mais ils ont certainement de la bonne volonté.
Pour l’avenir du SCI, il peut être nécessaire, tout en conservant les valeurs originales, de réfléchir à la manière d’aborder les aspects les plus négatifs de notre époque afin de mieux respecter les différences, les droits de l’homme et d’adopter une approche plus pacifique pour la résolution des conflits.