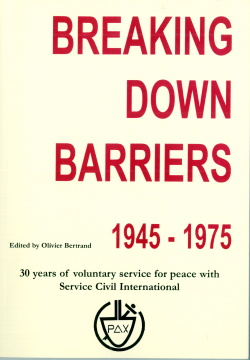Claire Bertrand (Valentin)
Des vacances en Norvège débouchent sur un engagement
J’ai grandi pendant la Guerre mondiale qui m’a marquée, puisqu’une bombe est tombée sur notre maison et a miraculeusement épargné ma famille. Quand j’étais étudiante, j’ai connu le SCI en 1959, par une amie qui allait dans un chantier en Norvège pour les vacances. Contrairement aux règles qui supposaient une expérience préalable en France, le SCI a accepté que j’y participe aussi. Je cherchais seulement à faire quelque chose de mes vacances. C’était un chantier traditionnel d’aménagement d’une maison pour handicapés (voir Kader), près d’Oslo et de la mer, Le travail était assez dur, il avait notamment fallu aplanir un terrain pour servir de zone de jeux, mais les conditions étaient exceptionnelles : on logeait dans une maison mise à disposition par la communauté, il n’y avait pas à faire la cuisine, qui était bonne.
Le travail se terminait vers cinq heures et on allait à la plage. Il y avait une vingtaine de volontaires, dont une Indienne, Valli (voir chapitre 3), devenue ensuite une grande amie, de très jeunes Anglais, un Hollandais et deux Libanaises. Nous avions des discussions intéressantes, qui ont commencé à m’ouvrir l’esprit. C’était des vacances à l’étranger, pendant trois semaines ou un mois, dans une ambiance sympathique, qui correspondait à mes idées, au besoin de faire quelque chose d’utile. Je ne suis pas sûre qu’en fait l’utilité de ce travail ait été très grande.
A mon retour, j’ai commencé à faire des chantiers de week-end, en partie parce que les volontaires libanaises nous avaient annoncé qu’elles organisaient un chantier l’année suivante et parce que je pensais qu’une expérience en France était un préalable pour y participer. Il s’agissait d’abord de la remise en état d’appartements de personnes âgées (à l’époque particulièrement démunies), que nous faisions dans la journée. Ce travail aboutissait à un résultat concret et était satisfaisant pour les volontaires comme pour les intéressés. Et il a contribué à me faire prendre conscience de leurs conditions de vie.
Avec les Maghrébins sur le bidonville
Mais assez rapidement, et jusqu’au printemps 1961, j’ai rejoint pendant le week-end la petite équipe du SCI qui travaillait sur un bidonville en banlieue, à Nanterre, pour des immigrés algériens et marocains. On était en pleine guerre d’Algérie et l’atmosphère était tendue. La responsable de cette action, Monique Hervo, qui vivait en permanence sur place, était très engagée en faveur de l’indépendance algérienne et avait des contacts avec le parti nationaliste. La branche française du SCI, tout en sympathisant avec la cause algérienne, ne souhaitait pas d’engagement à caractère clairement politique, de sorte que cette action s’est poursuivie de manière assez indépendante du mouvement [1].
Notre petit groupe venait régulièrement assister Monique Hervo et Marie-Ange Charras, qui s’occupaient surtout des relations avec la population locale et avec les administrations. Nous faisions un travail manuel de rafistolage des baraques, notamment en réparant les toits en tôle goudronnée. Du point de vue du type de travail, ce chantier était proche du modèle traditionnel des chantiers SCI, avec un travail assez dur et des conditions d’existence spartiates On travaillait davantage que dans les chantiers d’été, mais seulement le week-end et sans participation internationale. Mais le chantier était international du point de vue de la population pour laquelle on travaillait. Il est vrai que si notre travail de rafistolage se faisait entre volontaires, le contact étroit que Monique entretenait avec les habitants du bidonville nous assurait une bonne intégration. J’accompagnais rarement les femmes dans leurs démarches, mais je me souviens combien c’était pénible, car on était très mal reçu dans les administrations et on se sentait très impuissants.
Je n’ai jamais ressenti la pénibilité du travail. Je pense qu’il n’était pas inutile et que sans nous les Algériens auraient difficilement pu le faire, car ils n’avaient pas les moyens d’acheter les matériaux. Mais ce qui comptait, c’était le fait que l’on soit là [2], le sentiment de solidarité qu’eux et nous ressentions.
Le chantier de Nanterre a été beaucoup plus intéressant que les chantiers d’été. Il a correspondu pour moi bien davantage à l’idée du Service civil. De plus, j’allais à cette époque à des réunions où l’on discutait beaucoup, notamment de non-violence et de la guerre. J’admirais l’engagement de Monique et le travail à Nanterre était pour moi une forme d’engagement, notamment vis-à-vis de la guerre d’Algérie.
Pendant la même période, je suis restée en relations avec Valli, qui était en stage au Secrétariat du SCI à Clichy. J’ai honte de penser aux conditions dans lesquelles elle était accueillie. Très isolée, sauf la présence de Dorothy, elle vivait sans confort et sans chauffage, elle était pour la première fois coupée de sa famille et elle devait surmonter un choc culturel très dur, par exemple du fait qu’elle était végétarienne, ce qui était très rare à l’époque. Mais je me suis sentie très proche d’elle.
Au Liban : découverte du monde arabe
Pendant l’été 1960, les deux volontaires libanaises de Norvège nous ont invités à les rejoindre pour un chantier qu’elles organisaient à Beit el Din, en zone druze. Le voyage a été une expérience extraordinaire : j’ai pris un bateau qui faisait des escales en Méditerranée ; je couchais sur le pont, avec les familles grecques et leurs poules ; j’ai fait la connaissance d’un autre volontaire, Rob Buijtenhuis (nous sommes restés amis jusqu’à sa mort), avec qui nous descendions faire les provisions aux escales.
Au Liban, j’ai découvert une autre face du monde, puisque auparavant j’étais surtout une admiratrice des kibboutz et du socialisme israéliens. Il y avait des volontaires de différents pays arabes, résidant au Liban, dont quelques filles. Ils m’ont donné une autre version du problème palestinien que celle que j’avais jusque là : ils avaient fui la Palestine, les faits étaient là, il n’y avait même pas de discussion.
C’était aussi mon premier contact avec le monde arabe. Celui-ci ne m’a pas paru si étranger, mais j’ai quand même découvert des traditions très différentes comme les mariages arrangés et les relations entre garçons et filles, qui ont fait l’objet de beaucoup de discussions. Il me semble pourtant maintenant qu’à l’époque les différences entre l’Europe et le Moyen Orient sur ce point étaient moins grandes qu’aujourd’hui.
Ce chantier a été très inefficace, car il s’agissait de construire une école avec un architecte souvent absent et des matériaux arrivant très tard. A la fin, avec leur arrivée tardive, il a fallu travailler vite et dur, alors qu’il faisait très chaud, mais on n’a pas fini la construction. Si on ne travaillait guère, il y avait beaucoup de discussions, organisées ou non.
Mais ce chantier m’a ouvert l’esprit et a été un apprentissage de la relation avec l’autre. Plus généralement, il n’y a aucun doute que ma participation aux chantiers après la Norvège – qui était encore conforme au système occidental - a changé ma manière de voir le monde et a été une ouverture extraordinaire vers celui dans lequel je voulais entrer. L’esprit du Service civil correspondait très bien à mes préoccupations de l’époque, concernant par exemple le développement communautaire. Je suis restée fidèle à cet esprit et ce n’est sans doute pas un hasard si j’ai longuement travaillé avec Amnesty International, en particulier sur Israël et la Palestine.
En 1961, je m’étais inscrite comme volontaire à long terme pour le projet d’aide aux réfugiés tibétains à Kasauli en Inde (voir chapitre 3), mais j’y ai renoncé pour me marier avec un autre volontaire rencontré à Nanterre. Nous avons cependant gardé le contact avec le SCI lors de notre séjour en Thaïlande en 1962-66, où nous avons tenté de démarrer des activités avec les responsables asiatiques : Valli et Sato notamment. J’ai brièvement participé à un chantier au Sud-Est de la Thaïlande, où nous avions essayé de creuser un puits avec des volontaires thaïs réunis par une mission protestante. Le travail n’était pas très dur, mais les conditions locales un peu difficiles et je ne pense pas que nous ayons totalement abouti. Nous avons aussi participé à des week-ends avec des handicapés (voir Ann Kobayashi).
________________
[1] Monique Hervo a publié plusieurs ouvrages sur les années 1959 à 1962 passées sur le bidonville de Nanterre, où « des milliers de tôles enchevêtrées se mêlaient à des briques cassées ». Elle décrit la guerre d’Algérie transposée au bidonville : « Au fil du récit, la vie des Algériens puis celle des Maghrébins sans distinctions, devient de plus en plus dure. Insalubrité, promiscuité et cette peur qui est toujours là. A mesure que l’atrocité devient la norme en Algérie, le climat social se durcit au bidonville qui subit le contrecoup de la violence et de l’horreur... En 1961, intensification de la guerre. Le répression s’amplifie. Les habitants doivent faire face aux innombrables arrestations, fouilles des baraques, représailles opérées par des descentes musclées sur le bidonville. Certains disparaissent ». Monique Hervo, Marie-Ange Charras, Bidonvilles, Paris, Maspero, 1971. Et : Chronique d’un bidonville, Nanterre en guerre d’Algérie, par Monique Hervo, préface de François Maspéro, éditions du Seuil, 2001 p., ".
[2] « Ce qui bouleverse le plus Monique Hervo, c’est peut-être de savoir qu’à deux pas de là, les Français, indifférents, vivent dans la quiétude » MFI Hebdo, 29.11.2001.